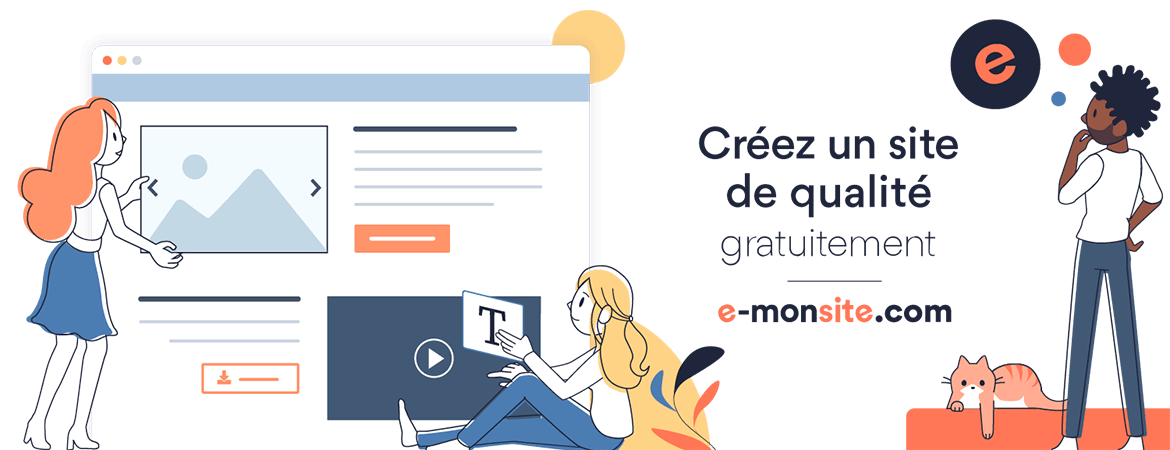Jeune artiste
-
Le luxe de l'insouciance
- Par
- Le 23/03/2017
- Dans Parcours d'une renaissance
- 0 commentaire

Diamant mandarin - gouache sur papier - janvier 2011
« Apprendre à observer et maîtriser les techniques de manière à pouvoir entamer dans de bonnes conditions une recherche personnelle créative et pertinente. Savoir utiliser la technique comme un outil au service de sa sensibilité et de sa créativité et non comme une finalité ». Tel est l’objectif précisé dans la Convention de Formation Professionnelle intitulée « Formation dessin, graphisme et couleur, peinture acrylique » que j’ai signée dans le cadre de mon DIF. Même s’il s’agit d’une formation « professionnelle » (DIF oblige), il n’est pas question pour moi de la transformer en projet professionnel.
Je débute le 13 septembre, à la fréquence d’une séance hebdomadaire de trois heures, le lundi après-midi. Je retrouve dans l’organisation proposée par l’atelier ce que j’avais apprécié lors des séances de peinture vécues en entreprise : Delphine accompagne ses élèves à leur rythme. Pas d’objectif à réaliser, pas de validation d’acquis. Les étapes sont définies en fonction des progrès, des sensations et des envies. Cette situation est nouvelle pour moi. Jusqu’ici, j’ai toujours mis dans ce que j’ai entrepris un objectif à atteindre ou un résultat à obtenir.
Quand j’étais Scout, dans les années 60-70, le diplôme avait la forme des badges et insignes qui font la fierté du Louveteau qui les a obtenus, par son habileté et son courage, et l’admiration de celui qui n’a pas encore fait sa Promesse. J’avais pu en glaner quelques-uns mais mon rêve était qu’ils recouvrent la manche gauche de mon pull marine, comme c’était le cas pour ceux que je considérais comme des « costauds ».
À la même époque, j’avais fait du judo, sans grande motivation. Ce sport était censé développer la force et la maîtrise de soi. J’y voyais surtout la possibilité d’apprendre à me défendre. Pour ce faire, il fallait être mis en situation, c’est-à-dire… se faire attaquer, ce que je redoutais. Chuter, faire chuter, ce n’était pas ma tasse de thé. Et puis je n’aimais pas l’odeur du tatami sur lequel j’avais trop souvent le nez collé. Pourtant je m’efforçais de le faire correctement pour obtenir, avec fierté mais sans conviction, les ceintures jaunes, oranges puis vertes. Plus on grimpait dans l’échelle des ceintures, plus les combats étaient rudes et les affrontements pénibles.
En 1970, je me suis essayé au sport d’équipe avec le hand-ball. Un copain de lycée, François B., m’avait proposé de le rejoindre dans son club. Il faisait figure de rebelle dans la classe, n’ayant peur de rien et surtout pas de l’autorité. Il jouait de la clarinette et sa mère était directrice de casting dans une agence de pub, ce qui m’avait permis de faire un essai devant la caméra pour une pub qui n’a jamais vu le jour. Sur une photo du tournage, je me souviens regarder François avec un air complice, chacun de nous ayant un gros cigare à la main. Le côtoyer c’était créer la possibilité du transgressif et de l’interdit. Faire du hand-ball avec lui c’était entrer dans son cercle et prendre une part de cette rébellion qui me fascinait. Sur le terrain, François était un avant-centre perceur de défense, et moi je n’ai jamais marqué un but. Sans cette consécration, je n’existais pas. Lors des matches, j’étais plus souvent sur le banc que sur le terrain. Mon engagement n’a duré qu’une saison et j’ai considéré que les sports collectifs n’étaient pas faits pour moi.
Je suis arrivé à l’escalade deux ans plus tard, à seize ans, en répondant à la sollicitation d’un camarade qui m’avait proposé de rejoindre en vélo la maison familiale dans les Alpes. Nous nous sommes entraînés dans la forêt de Fontainebleau où il pratiquait régulièrement la varappe. J’ai été convaincu par cet exercice entre terre et ciel, défi lancé à la gravité. En escalade, les difficultés sont évaluées au moyen d’une cotation qui va de F (facile) à ABO (abominable). En gravir les échelons était un but et, même si rien ne m’obligeait à le faire, je mettais toujours la barre plus haut, la sanction de la chute me permettant d’évaluer si j’étais ou non au niveau.
En pratiquant ces activités, il y avait toujours pour moi un objectif précis. Si je n’y arrivais pas, si je ne décrochais pas le Graal, je n’étais pas bon, pas à la hauteur. Aujourd’hui, j’ai peu de repères avec la peinture et le dessin. Ma seule motivation est d’apprendre. Quarante années sont passées et j’ai moins besoin qu’autrefois de prouver aux autres que « je suis capable ». Tout se passe entre moi et moi. Plus de chef de patrouille à qui obéir, plus de prof de sport qui sanctionne, plus d’entraîneur qui sélectionne. C’est jouissif de pouvoir arriver aller en cours sans devoir justifier d’un travail accompli. Le travail n’est pas un problème mais, pour la première fois de ma vie, je me sens libre de faire ou de ne pas faire. Avec cette formation, je découvre le luxe de l’insouciance. C’est bon la légèreté !
Le lundi 13 septembre 2010, jour de mon premier cours, je me sens comme un premier jour d’école : un peu d’administratif, une liste de matériel à acheter et une entrée en matière ludique. J’entre dans le vif du sujet avec une nature morte à dessiner au crayon noir. Rapidement, je passe du ludique au problématique. Je n’arrive pas à reproduire avec précision ce que je vois. Dire que le dessin est imprécis est un euphémisme. Delphine a l’œil aiguisé pour repérer quand un élève est en difficulté. Mais, en bon professeur et en pratiquante assidue du croquis, elle sait que sans se trouver confronté aux problèmes de la perspective et des proportions, de la lumière et de l’ombre, du choix de l’outil et du support adéquats, l’élève n’a aucune chance de parvenir à l’autonomie et l’enseignement du professeur de s’ancrer sur du vécu.

Beauté colorée – pastel - mars 2011
Toujours bienveillante, jamais complaisante. Ces qualificatifs traduisent la façon dont je vis l’accompagnement de Delphine. Nous ne restons pas plus de deux ou trois séances sur un media : après le crayon à mine de graphite et les natures mortes simples (un pot, une cruche, un fruit), je travaille l’encre de chine avec des outils divers (pinceau, plume, bambou taillé ou calame) pour des modèles plus complexes (batteur à œufs, mini cactus et « Chucky », l’ours en peluche). Les 3 heures passées en atelier ne rassasient pas mon envie d’apprendre, à moins que ce ne soit mon besoin de réussir. Les outils, comme les modèles, sont simples, facilement transportables. Tout objet devient matière à dessin, prétexte à dessiner : à la maison, ce sont la table à repasser, la souris de mon ordinateur, un téléphone portable et les verres.
J’aime tracer l’ovale de la partie supérieure d’un verre. Je trouve ce mouvement agréable à faire. Je détecte en écrivant ces lignes que si l’ovale me plaît c’est parce qu’il supporte l’imprécision. Un rond, s’il n’est pas parfait, n’en est plus un. Une ligne droite ne mérite pas ce qualificatif si elle n’est absolument rectiligne. Dans ces deux exemples, la moindre imperfection se sent si elle ne se voit pas. Avec l’ovale, je trouve que c’est supportable. Ça permet de travailler avec moins de pression. Dessiner des verres à eau, des verres à pied, des bouteilles est un de mes défis favoris.
Après l’exploration du crayon noir et de l’encre, je termine le dernier trimestre 2010 avec de la couleur : les crayons, puis le pastel et, enfin, la peinture avec la gouache. Aux natures mortes viennent s’ajouter les portraits et les animaux. Je travaille aussi les drapés.
Chaque séance est l’opportunité d’un challenge dans lequel je m’investis à fond, en quête de l’approbation de Delphine, toujours encourageante, distillant des conseils pertinents au moment opportun.
Je garde de cette période septembre-décembre 2010 un souvenir joyeux. Ma préoccupation de trouver une activité professionnelle reste présente mais passe au second plan. Le présent est occupé à mettre en pratique les enseignements reçus à l’atelier. Qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il vente, je savoure sur mon vélo les 15 kilomètres que je parcours chaque semaine pour rejoindre Chelles d’où je repars à chaque fois avec la satisfaction d’avoir appris quelque chose de nouveau et qui renforce ma confiance en ma capacité d’avancer.
Rien n’est simple mais j’ai le goût de l’effort, alors tout va bien ! Je jouis de ma situation comme je n’ai pas le souvenir de l’avoir déjà vécu.
-
Ça, on ne l'apprend pas à l'école
- Par
- Le 23/10/2016
- Dans Articles 2016
- 0 commentaire

Tissayoxa 12 - Acrylique sur carton toilé - 20x20 - 2016
Tout comme le jeune agriculteur sorti de formation, le jeune artiste se trouve confronté à la vie réelle.
Le premier sera soumis au rythme de la nature et le second au aléas de sa créativité. Mais l'un et l'autre sont soumis au rythme de LA création "tout court".
Le jeune agriculteur sait que de la façon dont il prendra soin de la terre dépendra la qualité de sa récolte. S’il plante trop tôt ou trop tard, s’il ne traite pas avec les produits appropriés ou s’il récolte au mauvais moment, il n’aura pas de beaux fruits. Ce n’est pas lui qui crée les fruits. C’est la terre qu’il aura cultivée, nourrie, laissée reposer. Il sait ce qu’il plante, mais n’a aucune certitude sur le produit de la récolte. Et les obstacles potentiels sont nombreux : le gel précoce ou tardif, la sécheresse, le grêle, les inondations…
Heureusement, l’école l’a préparé à tout cela. Il dispose de recettes, d’outils et de produits que la science et, surtout, des siècles d’expériences de ses ancêtres ont élaborés pour limiter, tant que possible, l’impact des catastrophes et maximiser le rendement. C’est ensuite par sa connaissance des cycles naturels de l’exploitation et le choix des produits que l’agriculteur donnera (ou pas) à sa production un caractère unique, reconnaissable.
Pour l’artiste, pas d’école pour lui apprendre les saisons et les cycles de la création. Comme ses prédécesseurs, il devra tout découvrir par lui-même. Il faut dire que la terre qu’il doit cultiver n’est pas visible : elle est intérieure, ne se voit pas et ne se décrit pas. Le fruit, c’est l’œuvre, et ce n’est pas l’artiste mais la terre artistique qui le produit.
Dans mon article « A quoi fonctionne mon moteur », publié en mai 2015, j’évoquais un reportage qui m’avait marqué, dans lequel j’avais vu le duo Souchon/Voulzy se balader en forêt et préciser que ça leur était indispensable pour renouveler leur énergie créatrice. Et j’ajoutais : « leur travail, c’est ça !». Je l’avais perçu mais pas intégré. Aujourd’hui, je l’ai compris. Il aura fallu 18 mois pour que la graine plantée en voyant le reportage produise le fruit de ma prise de conscience : l’œuvre ne sera puissante que si j’ai pris soin de la terre qui la fera naître.
Ce n’est pas en peignant des toiles que j’ai engendré cette compréhension ; c’est en me questionnant, en retournant dans ma tête mes certitudes et mes doutes tel le jardinier qui bêche. Si je le fais, au moment où ma terre artistique en a besoin, les fruits viendront d’eux-mêmes. Et ça, on ne l’apprend pas à l’école…
-
Like ou pas Like : quelle importance ?
- Par
- Le 04/09/2016
- Dans Articles 2016
- 0 commentaire
 Tamerai - Acrylique sur toile - 100x100 - 2016
Tamerai - Acrylique sur toile - 100x100 - 2016Qu'il soit présent sur Facebook, Linkedin, Artquid, Instagram, Twitter ou un blog, le jeune artiste qui publie un article ou poste une image espère une réaction sous la forme de commentaire, de "like", de pouce levé, de "coup de cœur", de partage ou de nouvel abonnement. Il fut un temps où j'attendais le commentaire comme un amoureux attendait autrefois fébrilement le facteur.
Après mes premières publications sur Artblog (plateforme aujourd'hui disparue), je me souviens de mes déceptions de ne voir aucune réaction à mes articles alors que d'autres multipliaient les likes et commentaires avec une simple photo de chatons. Et puis je me suis rendu compte que 95% des commentaires étaient davantage une manifestation d'affection ou d'appartenance à un groupe et ne servaient qu'à dire "je suis là !", quelque soit la nature ou le contenu de la publication. Si j'avais peu de commentaires, au moins ne se limitaient-ils pas à un seul mot (super, bravo, bisou...) et me faisaient-ils découvrir un regard sur mon article. J'ai compris que n'avoir aucun commentaire ou "j'aime" ne signifie pas que le travail n'est pas bon.
Aujourd'hui, je ne suis plus, comme au début, affecté par l'absence de réaction à mes publications. Bien sûr, un commentaire ou un like restent des boosters mais ils sont surtout des indicateurs de pertinence qui m'amènent à chercher ce qui a suscité ou non l'intérêt.
C'est aussi une question de maturité. L'Art, c'est la vie, celle qu'on vit tous les jours. Quand on est "petit", enfant ou élève, on a besoin d'encouragements, de soutien. C'est un élément important du développement et de l'apprentissage de la confiance. Au fil des années, celle-ci vient (ou pas), on donne un sens à sa vie (ou pas), on devient autonome (ou pas), on (ré)agit au lieu de rester passif... Chacun devient mature à son rythme. Certains le sont à 15 ans, d'autres à 70 ans ou jamais...
Je ressens la même chose avec l'Art. Bébé artiste a besoin d'être stimulé, encouragé ; l'artiste mature, lui, sait qui il est et le sens de son action. Puis, avec l'apprentissage et l'acceptation de la solitude, il n'a plus (en tous cas il a moins) besoin de "likes" et de commentaires pour avoir une preuve de son existence. Après avoir compris son rapport à lui-même, il peut davantage se consacrer au rapport à l'autre.
-
(Res)Sentant de solitude
- Par
- Le 14/07/2016
- Dans Articles 2016
- 0 commentaire
 Onirik 1 - Acrylique sur carton toilé - 50x70 - 2016
Onirik 1 - Acrylique sur carton toilé - 50x70 - 2016Mes lectures m'amènent régulièrement à des passages ou citations de Carl Gustav Jung (1875-1961), médecin psychiatre suisse et penseur influent.
J'y reviens périodiquement pour mettre des mots sur ce que je ressens comme, aujourd'hui, la solitude de l'artiste. Je me souviens avoir perçu sa présence un jour de juillet 2012, prenant conscience qu'elle ferait désormais partie de ma vie mais pas sous la forme que j'imaginais et sans que je puisse définir précisément mon ressenti.
J'ai retrouvé dans un passage d'un livre de Jung ("Ma vie"), ce que j'en perçois :
"...je sais et dois mentionner des choses que les autres, à ce qu'il semble, ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître. La solitude ne naît point de ce que l'on n'est pas entouré d'êtres, mais bien plus de ce que l'on ne peut leur communiquer les choses qui vous paraissent importantes, ou de ce que l'on trouve valables des pensées qui semblent improbables aux autres. ...Quand un homme en sait plus long que les autres, il devient solitaire. Mais la solitude n'est pas nécessairement en opposition à la communauté, car nul ne ressent plus profondément la communauté que le solitaire ; et la communauté ne fleurit que là où chacun se rappelle sa nature et ne s'identifie pas aux autres."
Le jeune artiste cherche des repères et ne peut compter que sur lui-même pour les trouver. Ses rencontres, ses réflexions sur ce qu'il vit lui apportent des références qui l'amèneront, peut-être, à de nouveaux repères. De par sa fonction, l'artiste dispose d'une collection unique de repères qui le rend identifiable et différent.
Les occasions de partage sur ce type de sujets sont rares et c'est presque une délivrance - et toujours une joie profonde - que de pouvoir les évoquer lors d'une conversation en sentant que l'autre sait, exactement, par quoi et par où passe votre réflexion. Dans ces moments là, on peut livrer en toute confiance une confession intime à un inconnu qui est tout sauf un étranger.
Je trouve que cette solitude, indispensable au développement de l'artiste mais parfois un peu lourde à porter, ressemble à la compagne évoquée par Georges Moustaki dans "Ma solitude".